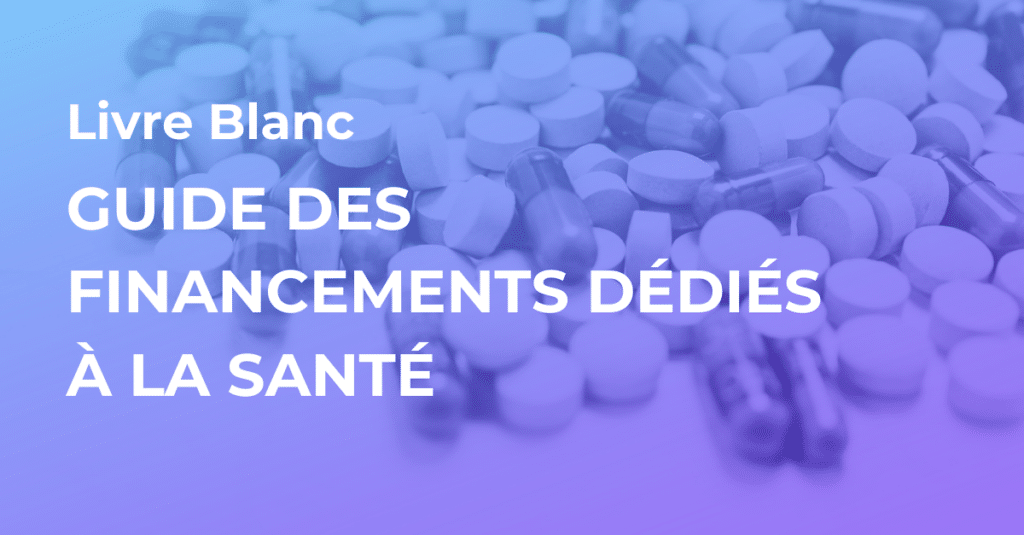Présentation générale du secteur
Enjeux du secteur
Le secteur aéronautique est au cœur des défis de notre siècle. En effet, il doit répondre à une double exigence : concilier la croissance du transport aérien tout en réduisant son empreinte environnementale. L’aviation représente aujourd’hui environ 2,5 % des émissions mondiales de CO₂. Malgré son apparence modeste, ce chiffre prend une importance critique en raison de la croissance continue du trafic aérien et des effets indirects liés aux traînées de condensation et aux oxydes d’azotes (Nox), qui amplifient le réchauffement climatique. A ce titre, certains travaux estiment que l’aviation expliquerait jusqu’à 3,5 % de l’effet radiatif total sur le climat.
La dépendance du transport aérien au kérosène, carburant fossile à très forte densité énergétique, pose un défi majeur de durabilité. Dans ce contexte, le développement de carburants alternatifs devient un enjeu stratégique pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Cet objectif a été fixé par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et soutenu par la plupart des compagnies aériennes. Cette transition ne répond pas seulement à une exigence environnementale. Elle vise aussi à renforcer la souveraineté énergétique et à stabiliser les coûts d’exploitation dans un contexte de volatilité du pétrole.
Aujourd’hui, la grande bataille du secteur se joue sur le terrain des carburants. Les carburants durables d’aviation (SAF) constituent la voie la plus concrète à court terme. Fabriqués à partir de résidus agricoles, d’huiles usagées ou de déchets organiques, ils peuvent être utilisés sans modification majeure des moteurs existants, ce qui facilite leur adoption progressive par les compagnies. De ce fait, leur déploiement permettrait de réduire jusqu’à 80 % des émissions de CO₂ sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Les carburants de synthèse (e-fuels) représentent l’une des pistes les plus prometteuses pour l’avenir de l’aviation. Produits à partir de CO₂ capté et d’hydrogène vert, ils ont l’avantage majeur de pouvoir s’intégrer aux infrastructures existantes, sans bouleverser la logistique ni les moteurs actuels. Le défi reste toutefois de taille : leur fabrication demande encore beaucoup d’énergie et les coûts de production demeurent élevés. Mais les premiers projets pilotes montrent que la technologie est viable et que son passage à l’échelle industrielle pourrait devenir réalité dès la prochaine décennie.
L’hydrogène incarne sans doute la rupture la plus ambitieuse. Airbus prévoit le lancement d’un premier appareil à hydrogène d’ici 2035. En vol, cette technologie ne produit aucune émission de CO₂, mais son adoption nécessitera une refonte complète des infrastructures : production, transport, stockage cryogénique et distribution dans les aéroports. Les défis techniques et logistiques sont considérables, mais les avancées se multiplient.
Enfin, l’aviation électrique et hybride s’impose comme une solution complémentaire, adaptée aux trajets courts et à l’aviation régionale. Grâce aux avancées sur la densité énergétique des batteries, de nouveaux appareils tout-électriques pourront bientôt couvrir des distances comprises entre 300 et 500 kilomètres.
À cela s’ajoute l’amélioration continue de l’efficacité énergétique : moteurs plus sobres, structures allégées, matériaux composites et optimisation aérodynamique. Chaque nouvelle génération d’appareils permet désormais de réduire la consommation de 15 à 20 %. Combinés aux carburants alternatifs, ces progrès renforcent la trajectoire de décarbonation du secteur, confirmant que l’innovation restera la clé d’une aviation durable et compétitive.
Évolutions récentes
Depuis le début du siècle, la transition énergétique du secteur aéronautique est en marche. Plusieurs grandes évolutions structurent ce mouvement :
- Essor des SAF : De plus en plus de compagnies testent ou utilisent des mélanges intégrant jusqu’à 50 % de biocarburant, conformément aux normes de certification ASTM. Certaines lignes commerciales volent déjà avec ce type de carburant.
- Cadre réglementaire européen : L’Europe fixe le cap avec le programme ReFuelEU Aviation, adopté en 2023. Ce texte impose une part croissante de SAF dans le carburant distribué aux aéroports : 2 % dès 2025, 6 % en 2030, puis 70 % à l’horizon 2050.
- Hydrogène et électricité : Airbus vise un premier avion à hydrogène d’ici 2035, tandis que plusieurs start-ups développent des appareils régionaux électriques ou hybrides. Ces innovations ciblent d’abord les vols courts, mais pourraient à terme bouleverser tout le transport aérien.
- Investissements massifs : Les grands constructeurs (Airbus, Boeing, Safran, Rolls-Royce) et les compagnies aériennes (Air France-KLM, Lufthansa, United Airlines, etc.) s’allient à des producteurs d’énergie et à des start-ups pour sécuriser leurs approvisionnements en SAF. Ils préparent également l’arrivée des e-fuels, issus d’électricité renouvelable et de CO₂ recyclé.
- Pression sociétale : Les voyageurs, tout comme les ONG, demandent plus de transparence sur les émissions et les actions concrètes du secteur. Les compagnies répondent désormais avec des plans de décarbonation détaillés, où le carburant devient un levier central de leur stratégie RSE.
Cette dynamique traduit une prise de conscience collective : l’avenir de l’aéronautique dépend de sa capacité à innover dans le domaine des carburants.
Avenir du secteur
L’avenir des carburants aéronautiques ne reposera pas sur une seule technologie, mais sur un ensemble de solutions complémentaires.
À court terme (2025-2035), les carburants durables devraient rester le pilier central de la transition. Leur production mondiale devra croître rapidement : l’Agence internationale de l’énergie estime la demande à près de 450 millions de tonnes par an d’ici 2050. Pour atteindre ces volumes, la coopération entre énergéticiens, compagnies aériennes et constructeurs sera déterminante. Sans cette synergie, la montée en puissance restera symbolique.
À moyen et long terme (2035-2050), les carburants de synthèse et l’hydrogène prendront progressivement le relais. Leur potentiel dépasse celui des SAF, mais leur industrialisation demandera encore des investissements massifs, des standards communs et une décennie d’expérimentation avant un déploiement à grande échelle.
Au-delà de 2050, le transport aérien pourrait reposer sur un mix énergétique diversifié : électricité pour les liaisons courtes, hydrogène pour les vols moyens, et SAF ou e-fuels pour les long-courriers.
Aujourd’hui, les nouveaux carburants coûtent encore trois à cinq fois plus cher que le kérosène classique. Toutefois, cette différence devrait s’atténuer au fil du temps, grâce à l’augmentation des volumes et à la baisse des coûts technologiques. Le rôle des pouvoirs publics sera crucial pour garantir un cadre stable et encourager les investissements nécessaires.
Axes d’innovation
La transition énergétique du transport aérien ne repose pas seulement sur des avancées technologiques. Elle s’appuie sur une stratégie industrielle et politique de long terme, soutenue par des investissements publics considérables. L’Union européenne et les États membres ont fait du secteur aéronautique un levier majeur de leur politique de décarbonation. Ils mobilisent à la fois des fonds de recherche, des partenariats industriels et des mesures réglementaires structurantes.
Une politique européenne structurée autour de la neutralité carbone
Depuis 2021, la feuille de route européenne s’articule autour du Pacte vert pour l’Europe (Green Deal) et du programme Fit for 55, qui vise à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030. L’aviation y occupe une place particulière, du fait de sa forte dépendance aux énergies fossiles et de son rôle stratégique dans la mobilité internationale.
L’une des initiatives les plus emblématiques est le règlement ReFuelEU Aviation, adopté en 2023. Il impose aux compagnies aériennes d’incorporer un pourcentage croissant de carburants durables (SAF) dans leurs approvisionnements : 2 % dès 2025, 6 % en 2030, puis jusqu’à 70 % d’ici 2050. Cette obligation crée une véritable dynamique industrielle. Elle pousse les énergéticiens, raffineurs et acteurs du transport aérien à repenser leurs modes d’approvisionnement. L’objectif n’est plus seulement de réduire les émissions, mais de bâtir une économie circulaire du carburant, fondée sur la production locale et la valorisation des ressources renouvelables.
La logique est double : réduire les émissions, mais aussi créer une économie industrielle intégrée autour de la production et de la distribution de carburants durables. Aujourd’hui, l’aviation consomme encore près de 300 millions de tonnes de kérosène par an, soit environ 8 % de la demande mondiale de produits pétroliers. Le remplacement progressif de cette quantité par des carburants alternatifs suppose une montée en puissance sans précédent des capacités de production, estimée à plus de 60 milliards de litres par an d’ici 2050.
Une filière d’approvisionnement en reconstruction
La décarbonation du transport aérien repose désormais sur la capacité à bâtir des filières d’approvisionnement locales, intégrées et résilientes. L’enjeu ne se limite pas à produire des carburants durables, mais à structurer une chaîne complète : collecte de biomasse, électrolyse de l’hydrogène, captation du CO₂, raffinage et distribution en aéroport. Pour répondre à la future demande en carburants durables, l’Europe doit créer des filières d’approvisionnement locales et intégrées, capables d’assurer la production, le stockage et la distribution des SAF à grande échelle.
Aujourd’hui, la production mondiale de SAF ne représente qu’environ 0,1 % de la demande totale de carburant aérien. Pourtant, ce marché pourrait atteindre 65 milliards de dollars dès 2030, contre moins de 1 milliard actuellement. De ce fait, ce potentiel attire des investissements massifs, tant publics que privés.
La France, pour sa part, développe une approche similaire via ses grands pôles industriels (Normandie, Occitanie, Sud-Ouest) où cohabitent énergéticiens, équipementiers et constructeurs aéronautiques. Ces écosystèmes territoriaux permettent de mutualiser les investissements et de standardiser les procédés. En outre, ils permettent de renforcer la souveraineté énergétique nationale.
Carburants alternatifs : levier économique et industriel
Au-delà de la réduction des émissions, l’enjeu est aussi économique. Le transport aérien mondial pèse près de 4 % du PIB mondial en valeur directe et indirecte, et fait vivre plus de 65 millions de personnes. Sa décarbonation représente donc autant un impératif environnemental qu’une opportunité de croissance industrielle.
L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a fixé comme objectif une réduction de 50 % des émissions nettes d’ici 2050. Grâce à la combinaison des carburants alternatifs, de l’efficacité énergétique et des nouvelles technologies. Cet objectif, jugé ambitieux il y a encore quelques années, devient progressivement atteignable à mesure que les filières industrielles s’organisent et que les financements se consolident.
Mais cette transformation a un coût : selon les estimations de la Commission européenne, la mise en conformité du secteur aux exigences climatiques nécessitera plus de 820 milliards d’euros d’investissements cumulés d’ici 2050. Ces montants couvrent la recherche, les infrastructures, les capacités de production et la modernisation des flottes. Cependant, ils doivent être mis en regard des gains attendus : création d’emplois hautement qualifiés, consolidation de l’autonomie énergétique et renforcement de la compétitivité technologique du continent.
L’aéronautique est ainsi devenue un symbole de la transition industrielle européenne. L’Europe a posé un cadre clair, la France s’est alignée sur cette trajectoire, et les acteurs privés investissent massivement pour transformer cette ambition en réalité. À mesure que les projets montent en puissance, la filière aéronautique devient le laboratoire emblématique de la transition énergétique mondiale.
Appels à projets passés et en cours
Appels à projets nationaux
La France a fait de la décarbonation du transport aérien l’un des piliers de son plan France 2030. Ce programme mobilise plus de 54 milliards d’euros pour soutenir les filières industrielles stratégiques, dont l’aéronautique figure parmi les priorités. L’objectif : accélérer le passage vers des technologies de propulsion propres, développer les carburants d’aviation durables et renforcer la souveraineté énergétique nationale.
Dans ce cadre, Bpifrance pilote plusieurs dispositifs ciblant la recherche et la production d’aéronefs à faibles émissions. L’appel à projets « Produire en France des aéronefs bas carbone » accompagne les entreprises et consortiums innovants dans la conception de nouvelles générations d’avions, moteurs et équipements optimisés pour la transition énergétique. Il soutient les projets qui combinent innovation technologique, intégration industrielle et réduction mesurable des émissions de CO₂. Le dispositif s’adresse aussi bien aux grands groupes qu’aux PME de la filière, avec des financements sous forme de subventions et d’avances remboursables.
Parallèlement, le gouvernement a lancé l’appel à projets “Carb’Aéro”, dédié au développement et à la production de carburants d’aviation durables de synthèse. Sélectionnés en 2024, les quatre premiers lauréats illustrent la diversité des approches : e-fuels produits à partir d’électricité renouvelable, biocarburants issus de biomasse ou procédés innovants de captation du CO₂. Cette initiative vise à structurer une véritable filière française du SAF, capable d’alimenter les grands hubs aéroportuaires d’ici 2030.
Ces dispositifs nationaux s’ajoutent aux efforts de la DGAC et du CORAC, qui soutiennent plusieurs programmes technologiques, notamment sur la propulsion hydrogène et la sécurité des infrastructures aéroportuaires. En parallèle, l’ADEME intervient à un niveau plus transversal à travers des programmes comme DECARB IND 25, destinés à accompagner la décarbonation de l’industrie et la production de carburants à faibles émissions.
Tableau 1 : Etat des lieux des AAP nationaux passés et en cours
| Opérateur / Financeur |
Nom de l’AAP / Programme |
Organismes ciblés |
Objectifs principaux |
Date de clôture |
| Bpifrance / France 2030 |
Produire en France des aéronefs bas carbone |
Grands groupes, PME, start-up, laboratoires de recherche, consortiums industriels |
Soutenir la conception et la production d’aéronefs à faibles émissions : propulsion hybride, nouveaux matériaux, optimisation énergétique et réduction du CO₂. |
Clôturé en décembre 2022 |
| Ministère de la Transition écologique / France 2030 |
Carb’Aéro – Carburants d’aviation durables de synthèse |
Entreprises énergétiques, industriels du raffinage, acteurs de la filière hydrogène et biocarburants |
Développer des unités de production de SAF à partir d’hydrogène vert et de CO₂ capté ; structurer une filière nationale d’approvisionnement. |
Appel lancé en 2024, clôturé en 2025 |
| DGAC / CORAC / Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) |
Projets de R&D aéronautique – propulsion hydrogène et hybridation |
Consortiums public-privé, centres de recherche, constructeurs et équipementiers |
Financer la recherche appliquée sur la propulsion décarbonée, la sécurité des infrastructures et la compatibilité des nouveaux carburants avec les flottes commerciales. |
Appels récurrents – prochains guichets attendus 2026 |
| ADEME / France 2030 |
DECARB IND 25 – Décarbonation de l’industrie |
Industriels, raffineurs, producteurs d’énergie, entreprises du transport et de la chimie |
Financer les projets de réduction d’émissions industrielles : production de carburants décarbonés, récupération de chaleur, électrification des procédés et substitution aux énergies fossiles. |
Clôturé en mai 2025 |
Ces appels à projets traduisent une stratégie claire : faire émerger des solutions technologiques matures (TRL 5-7), accélérer leur industrialisation et consolider la position de la France comme acteur majeur de l’aéronautique durable.
Appels à projets européens
À l’échelle européenne, la décarbonation du transport aérien s’appuie sur une stratégie cohérente : combiner la recherche amont, la démonstration industrielle et la mise sur le marché des nouvelles technologies. Cette ambition se déploie principalement à travers le programme Horizon Europe et les initiatives associées du Green Deal, qui font de l’aviation durable un axe structurant de la transition énergétique.
Le Work Programme 2025 du Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility” rassemble plusieurs appels à projets liés à la propulsion propre, aux carburants alternatifs et à l’optimisation énergétique du transport aérien. Les projets soutenus visent à développer des solutions de rupture : moteurs hybrides, systèmes électriques embarqués, infrastructures de stockage d’hydrogène ou encore chaînes logistiques pour carburants durables (SAF).
Le Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU) joue un rôle central dans ce dispositif. Ce partenariat public-privé, qui associe plus de 100 acteurs européens de l’aéronautique, finance la mise au point de démonstrateurs technologiques à grande échelle. Son Call 3 for Proposals (2025), doté d’un budget global de 950 millions d’euros, vise notamment à réduire de 30 % la consommation énergétique des futurs aéronefs, à accélérer l’intégration des carburants durables et à préparer l’usage de l’hydrogène liquide pour le transport aérien commercial. Ces projets contribuent directement à la feuille de route européenne “Clean Aviation by 2035”.
Cette convergence d’initiatives illustre la cohérence d’une stratégie européenne désormais pleinement structurée. L’objectif n’est plus seulement d’expérimenter, mais de passer à l’industrialisation des solutions bas carbone, une étape décisive pour faire de l’aéronautique un secteur aligné avec les engagements du Pacte vert pour l’Europe et du Fit for 55.
Tableau 2 : Etat des lieux des AAP européens en cours
| Opérateur / Financeur |
Nom de l’AAP / Programme |
Organismes ciblés |
Objectifs principaux |
Date de clôture |
| Commission européenne / Horizon Europe |
Work Programme 2025 – Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility” |
Consortiums européens (entreprises, universités, centres de recherche, start-ups) |
Financer la R&D sur les technologies de propulsion propre : moteurs hybrides, stockage d’hydrogène, systèmes électriques embarqués et logistique des SAF. |
Appels ouverts en 2025 |
| Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU) |
Call 3 for Proposals – Clean Aviation by 2035 |
Acteurs publics et privés du secteur aéronautique (constructeurs, équipementiers, laboratoires) |
Réduire de 30 % la consommation énergétique des futurs aéronefs, accélérer l’intégration des SAF et préparer l’usage de l’hydrogène liquide. |
Appel lancé en 2025 – budget global 950 M€ |
Exemple de cas d’innovation probants
Airbus ZEROe : le pari européen de l’avion à hydrogène
Parmi les nombreuses initiatives en cours, le programme ZEROe d’Airbus illustre parfaitement la dynamique d’innovation à l’œuvre dans le secteur aéronautique. Ce projet, lancé en 2020 et aujourd’hui au cœur de la stratégie bas carbone du constructeur, vise à développer le premier avion commercial à hydrogène d’ici 2035.
L’ambition d’Airbus repose sur une idée simple : substituer au kérosène un carburant propre, l’hydrogène liquide, capable d’alimenter une propulsion à zéro émission directe de CO₂. Pour y parvenir, l’avionneur mobilise un vaste réseau de partenaires industriels et scientifiques, parmi lesquels Safran, GE Aerospace, Air Liquide et plusieurs laboratoires européens. Le programme s’inscrit dans le cadre du Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU) et bénéficie de soutiens financiers du programme Horizon Europe et de France 2030.
Concrètement, le projet explore plusieurs configurations d’appareils. Trois concepts sont actuellement étudiés :
- un avion à turbopropulseurs hydrogène, destiné aux vols régionaux ;
- un biréacteur moyen-courrier, propulsé par des turbines adaptées à la combustion d’hydrogène ;
- et un modèle à fuselage intégré, pensé pour optimiser le stockage et la distribution de l’hydrogène.
Chaque architecture répond à un équilibre différent entre autonomie, charge utile et intégration technique. L’enjeu est considérable : stocker l’hydrogène liquide à –253 °C, tout en garantissant sécurité, performance et compatibilité avec les normes aéronautiques existantes.
En parallèle, Airbus teste un démonstrateur technologique basé sur un A380 modifié. Ce laboratoire volant servira à valider les systèmes de stockage, les nouveaux moteurs à hydrogène et la gestion thermique du carburant. Les premiers essais en vol sont prévus à partir de 2026, avec l’objectif de valider la faisabilité d’un avion commercial hydrogène avant la fin de la décennie.
Le programme va bien au-delà de la conception d’un appareil. Il implique la création d’un écosystème complet : production d’hydrogène vert, logistique aéroportuaire, normes de sécurité, et formation des équipes au sol. Airbus collabore notamment avec Airbus UpNext, Air Liquide et plusieurs grands aéroports européens (Toulouse, Hambourg, Rotterdam) pour tester les futurs circuits d’avitaillement.
Au-delà de la prouesse technologique, le projet ZEROe incarne une vision stratégique : celle d’une aviation européenne indépendante sur le plan énergétique et durable sur le plan climatique. Il traduit aussi une conviction : la décarbonation du transport aérien ne passera pas uniquement par des ajustements progressifs. Mais par une rupture assumée dans les technologies de propulsion.
Si les défis restent immenses (stockage cryogénique, coûts de production, adaptation des infrastructures), le programme ZEROe ouvre une voie crédible vers une aviation neutre en carbone. Il symbolise la nouvelle logique d’innovation : collaborative, transnationale et orientée vers la durabilité.
Take Kair : production française de e-kérozène
Le projet Take Kair illustre parfaitement la dynamique d’innovation portée par la France dans le domaine des carburants d’aviation durables. Lauréat de l’appel à projets Carb’Aéro du plan France 2030, ce programme vise à créer une filière nationale de production de carburants de synthèse destinés au transport aérien.
Implanté sur le site industriel de Donges, à proximité de Saint-Nazaire, Take Kair réunit deux acteurs majeurs. Hynamics, la filiale hydrogène du groupe EDF. Et, Meridiam, investisseur spécialisé dans les infrastructures durables. Ensemble, ils visent la production, d’ici 2030, de près de 50 000 tonnes de carburants de synthèse par an. Dont parmi eux 37 500 tonnes de e-kérozène, un carburant fabriqué à partir d’hydrogène vert et de CO₂ capté.
Au cœur du dispositif, un électrolyseur de 200 MW, parmi les plus puissants jamais installés en France, assurera la production d’hydrogène renouvelable. L’usine alimentera à terme les grands aéroports de l’Ouest, tout en valorisant les ressources locales en énergies vertes. Cette implantation stratégique illustre bien la logique de production régionale et circulaire qui émerge aujourd’hui dans l’industrie énergétique.
Soutenu par l’État à hauteur de 16,6 millions d’euros, Take Kair marque une étape décisive vers la montée en puissance industrielle des carburants alternatifs. Le projet ne se limite pas à l’innovation technologique : il incarne une vision complète de la souveraineté énergétique française, en reliant production d’hydrogène, synthèse du carburant et distribution locale.
Au-delà de son apport environnemental, Take Kair ouvre la voie à la structuration d’une filière française du e-fuel, capable de rivaliser avec les initiatives menées en Allemagne ou dans les pays nordiques. Ce projet prouve qu’il est possible de concilier ambition environnementale, ancrage territorial et compétitivité industrielle.
Bibliographie
- Ritchie, H. (2022). What share of global CO₂ emissions come from aviation? Our World in Data.
- Air Transport Action Group (ATAG). (2022). Aviation: Benefits Beyond Borders.
- International Energy Agency (IEA). (2023). Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector.
- International Air Transport Association (IATA). (2022). Aviation Net-Zero CO2 Transition Pathways, Comparative Review.
- Transport & Environment (T&E). (2023). Sustainable Aviation Fuels around the World.
- European Commission. (2023). ReFuelEU Aviation – Mobility and Transport.
- European Union Aviation Safety Agency (EASA). (2023). Fit for 55 and ReFuelEU Aviation.
- (2024). Appel à projets – Produire en France des aéronefs bas carbone. France 2030.
- Ministère de la Transition Écologique. (2024). Appel à projets France 2030 – Carb’Aéro : production de carburants d’aviation durables de synthèse.
- European Commission. (2024). Horizon Europe – Work Programme 2025, Cluster 5: Climate, Energy and Mobility.
- Clean Aviation Joint Undertaking. (2024). Institutional overview – Clean Aviation JU (European Union).
- Clean Aviation. (2024). Clean Aviation Call 3 – Proposals with €950 million research effort.
- (2024). ZEROe – The Future of Hydrogen Aviation.
- Hynamics & Meridiam. (2024). Take Kair – Projet d’usine de production de e-carburant pour la décarbonation du transport aérien, lauréat de l’appel à projets Carb’Aéro (France 2030).