Réussir sa transition biosourcée : des solutions concrètes pour les industriels
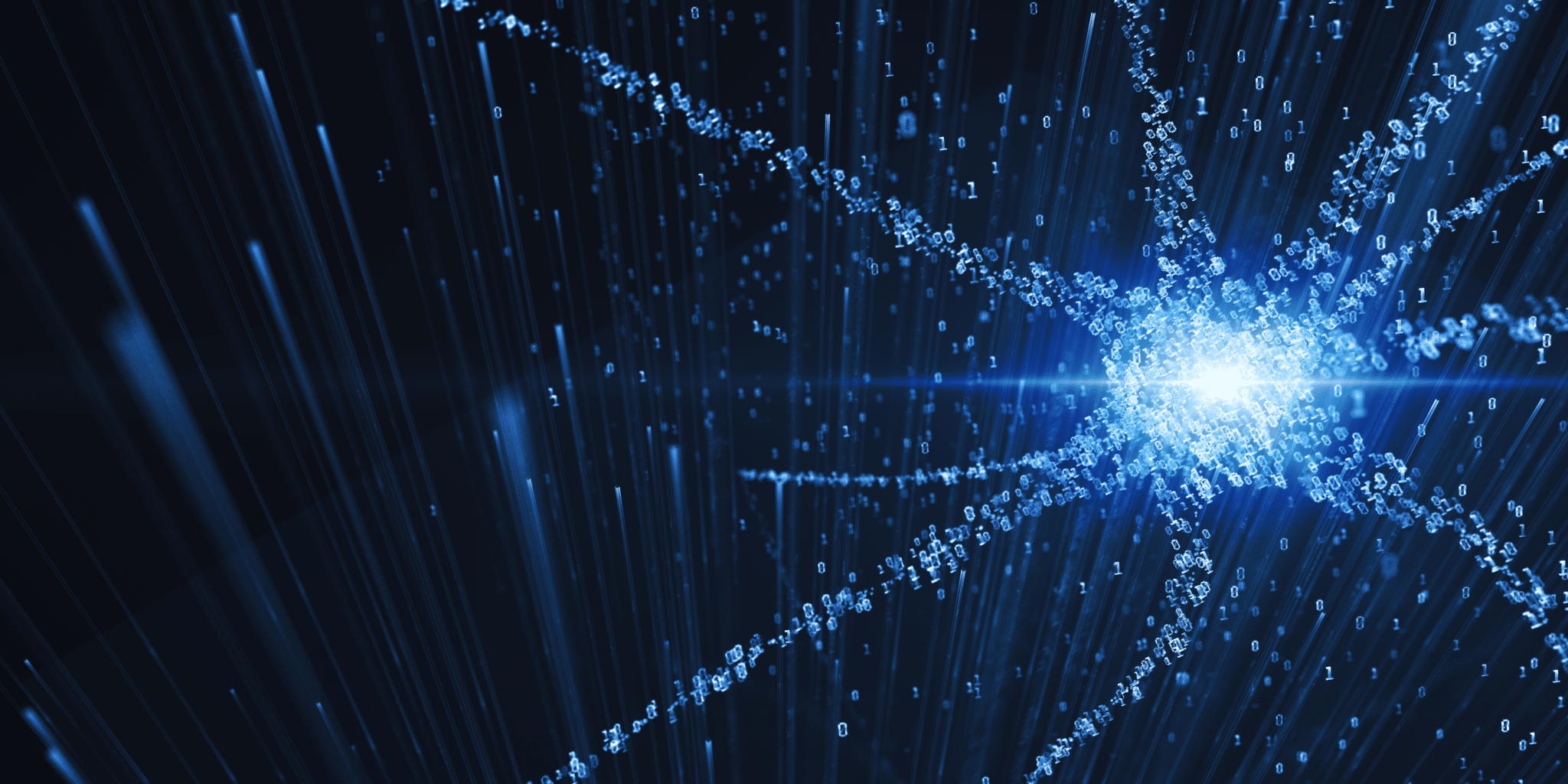

FR Média, Télécoms, TIC Actualités Regard d'experts
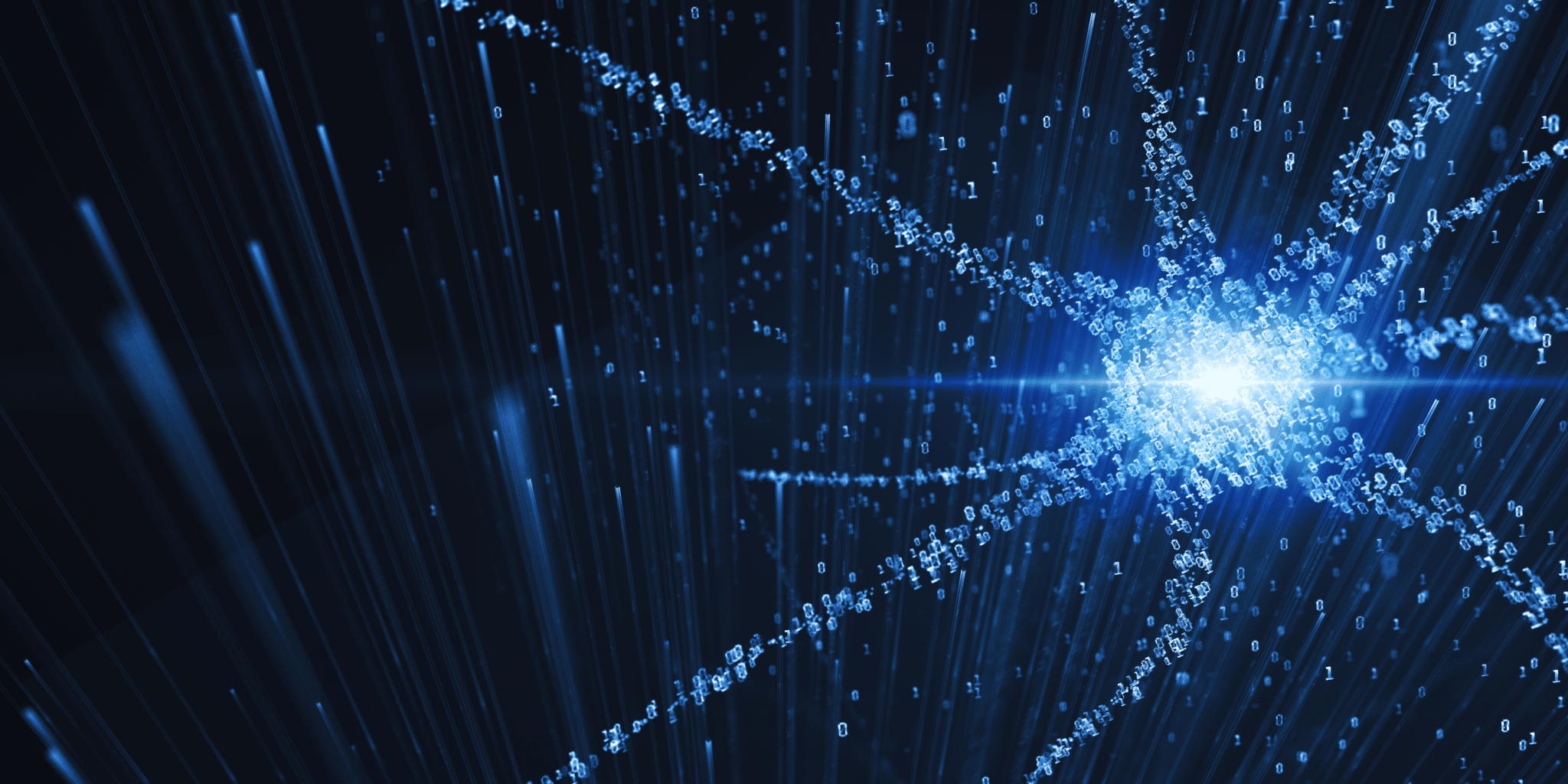

FR Média, Télécoms, TIC Actualités Regard d'experts
Une Entreprise de Services Numériques (ESN) accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Elle leur propose des services techniques tels que le conseil, le développement, et la maintenance de solutions informatiques. La vocation des ESN consiste donc à embaucher et former des profils qualifiés dans les domaines élargis du numérique, afin de constituer des pôles d’expertises spécifiques pour les offrir à leurs clients.
La croissance structurelle des ESN s’est révélée forte et continuelle depuis une vingtaine d’années comme le met en exergue une étude du cabinet KPMG. Notamment car “la confiance reste élevée avec 96% des entreprises se projetant vers l’avenir avec assurance, prêtes à atteindre leurs objectifs de croissance grâce à une stratégie claire et une vision tournée vers l’innovation et le numérique responsable”. En 2024, le marché du service numérique est évalué à 70,4 milliards d’euros en France.
En 2023, le chiffre d’affaires des grandes ESN réalisé en France est le suivant :
| Rang | Nom | Chiffres d’affaires en France
(M€)
|
| 1 | CAPGEMINI | 4 276 |
| 2 | SCC FRANCE | 2 617 |
| 3 | ACCENTURE | 2 387 |
| 4 | SOPRA STERIA | 2 039 |
| 5 | ATOS | 1 960 |
| 6 | IBM FRANCE | 1 740 |
| 7 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 1 495 |
| 8 | ECONOCOM | 1 457 |
| 9 | CGI France | 1 287 |
| 10 | ALTEN | 1 178 |
Comme toute entreprise de services, une ESN “n’a de richesse que d‘homme” pour citer Jean Bodin. De tels résultats économiques impliquent donc que ces structures mobilisent un nombre important de collaborateurs eux-mêmes fortement diplômés et disposant d’une expertise forte. Elles emploient une grande partie des salariés du numérique.
Compte tenu de leur ancrage dans le monde économique, des effectifs qu’elles mobilisent, de l’expertise technique de ces effectifs, ainsi que de leur imbrication forte dans le monde économique, les ESN constituent des acteurs impliqués dans des projets informatiques complexes, dont des projets de développement expérimental et / ou de recherche appliquée.
Ainsi, les ESN jouent un rôle clé dans l’innovation technologique et la recherche, grâce à leur investissement croissant dans la recherche et développement (R&D). Cette logique et ce dynamisme leur permettent de développer des technologies et des compétences, qu’elles mettent le plus souvent au service de leurs clients. Cela renforce ainsi leur légitimité à effectuer de la R&D pour des projets technologiques complexes. Ce positionnement leur confère également un avantage concurrentiel non négligeable. En effet, 85% de nos clients ESN affirment que leurs investissements R&D leur ont permis de remporter des marchés. Leurs clients sont en effet de plus en plus attentifs à la capacité des ESN à structurer, piloter et exécuter des projets complexes. Et donc surmonter des verrous technologiques et fonctionnels notables.
Les ESN investissent donc dans des laboratoires internes pour expérimenter de nouvelles technologies, créer des outils spécifiques et former leurs collaborateurs. Ce positionnement leur permet de participer à des projets nécessitant une innovation continue et une maîtrise avancée des technologies nouvelles et émergentes.
C’est pourquoi le secteur des ESN est l’un des principaux employeurs d’ingénieurs en France, avec une demande croissante pour des profils spécialisés. En 2023, près de 47 000 créations nettes d’emplois ont été enregistrées dans le secteur numérique, bien qu’un ralentissement ait été observé par rapport à 2022, qui constituait une année record. Par ailleurs, les ESN attirent de plus en plus de docteurs pour renforcer leurs capacités en R&D. Notamment dans des domaines comme l’algorithmique, la simulation numérique ou encore l’ingénierie système basée sur des modèles (MBSE).
Avec 74 % d’entreprises innovantes, le secteur élargi de l’information et de la communication est le plus innovant en France. Les ESN suivent la tendance, mais ne figurent pas dans les plus grands déposants de brevets en France. Le secteur des logiciels, services numériques et télécoms, auquel appartiennent les ESN, représente environ 10 % des brevets déposés en France chaque année, reflétant l’importance croissante de ce secteur dans l’innovation. Pour autant, comme évoqué, aucun acteur majeur des ESN n’apparait dans le palmarès des 50 premiers déposants en France. Le secteur numérique est toutefois connu pour être moins enclin et propice aux stratégies basées sur les portefeuille de brevets. Les ESN sont également généralement moins présentes dans les classements de publications scientifiques, en comparaison avec d’autres secteurs industriels.
Alors comment les ESN peuvent-elles valoriser le fruit de leur R&D et rayonner s’agissant de ces indicateurs R&D (propriété industrielle / publications scientifiques) sur lesquels elles sont encore en retrait ?
La R&D dans les ESN est souvent organisée de manière hybride pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients, tout en développant leurs propres compétences internes.
Deux grandes approches se distinguent.
La R&D est réalisée directement pour compte de tiers (clients), sans structuration globale au sein de la société. Cette R&D externalisée permet aux ESN de se positionner comme des partenaires d’innovation basée sur des ressources et des compétences plus ou moins continues. Ces activités R&D peuvent être de typologie suivante :
Certaines ESN disposent de laboratoires (« labs ») internes dédiés à l’innovation et à l’exploration de nouvelles technologies. Ces laboratoires jouent un rôle clé dans le développement d’outils et solutions nouvelles « propriétaires » et donc dans le positionnement stratégique de l’ESN au sein de l’écosystème technique du client. Les avantages associés sont les suivants :
De nombreuses ESN étaient historiquement axées sur le premier modèle, mais privilégient désormais la combinaisons des bienfaits issus des deux modèles. Elles testent d’abord des technologies nouvelles dans des labs internes, avant de les proposer à leurs clients. Par ailleurs, elles co-innovent avec leurs clients, souvent via des programmes de collaboration. Cette organisation permet aux ESN de rester compétitives sur des domaines en évolution rapide, mais aussi de se positionner comme un réel partenaire R&D, au-delà d’un fournisseur temporaire de compétences et ressources.
Les ESN peuvent être agréés au Crédit Impôt Recherche (CIR).
Si tel est le cas, leurs clients peuvent intégrer des dépenses facturées par les ESN dans leur propre CIR. Le donneur d’ordre (déclarant au CIR) doit alors démontrer que la prestation technique facturée par l’ESN est nécessaire à la réalisation de l’opération de R&D qu’il mène en interne.
Elles peuvent également déclarer dans leurs CIR certaines opérations de recherche menées par leurs équipes scientifiques.
Cela étant dit, la Loi (avec l’encadrement de la sous-traitance en cascade) et la jurisprudence (encadrant strictement les modalités de détermination du CIR d’un prestataire agréé) ont légitimement prévu des règles claires qu’il convient de respecter, afin d’éviter toute double valorisation d’une même dépense de recherche, dans deux CIR différents.
Par ailleurs, il est nécessaire de veiller à ce que ces activités de recherche concernées respectent les principes généraux suivants :
Pour sécuriser le CIR déclaré, les bonnes pratiques suivantes sont nécessaires, en particulier en environnement ESN :


Réussir sa transition biosourcée : des solutions concrètes pour les industriels
Aussi